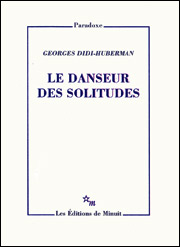Le Danseur des Solitudes
Georges Didi-Huberman
Aux Editions de Minuit
Je viens de refermer ce livre. Le danseur des solitudes. Déjà un titre évocateur. Je l’ai choisi pour le titre et pour Didi-Huberman, encore une fois, c’est un hasard qui fait que je me penche sur un de ses livres, une parenthèse heureuse après quelques petites déceptions dans mes récentes lectures. Je l’ouvre et je sais que je vais aimer, que je vais aimer le ton, que je vais aimer le sujet. Alors facilement je me laisse emportée.
Le point de départ de ce livre, j’hésite à l’appeler essai, c’est la rencontre avec ce danseur espagnol, Israël Galvàn, de sa performance chorégraphique Arena. Le sujet est subtilement amené, « on danse le plus souvent pour être ensemble ». Et doucement, émerge ce monde fait de solitude, de flamenco, de tauromachie… Et on y plonge, on ne reste pas dans une contemplation superficielle de l’expression des émotions. « Dans l’arène on est nu, et en même temps on est revêtu d’une interprétation, celle que demande l’œuvre. On est à nu parce qu’on est dans la clarté de l’expression ».
On ne nous rabâche pas de vieux discours sur le rapport à la vie, à la mort, aux passions. C’est bien plus subtil. Il n’y a pas de lieu commun sur le flamenco et encore moins sur la tauromachie. On est saisi.
On plonge dans un monde plus que dans un genre de danse. « Danser seul donc. Mais pour danser, au pluriel, ses solitudes. Refuser de plier son corps à la contrainte de l’unique et l’unité. Tout faire, en revanche, pour se plier-déplier sans cesse, pour se multiplier soi-même. »
On comprend le rapport de la danse aux mots sans aucune intellectualisation trop lourde.
Les pages sont ponctuées de ces mots en italiques, des mots en espagnol parce que c’est dans cette langue que s’exprime toute la multiplicité des sens. Ces petites lettres penchées, leur sonorité à la fois chantante et franche, les mots en italiques apparaissent comme des incisions dans le flot restant des mots droits et ronds qui remplissent les pages. Comme si à certains endroits, on avait gratté les mots pour revenir à la source de leur signification. Ce phénomène (mettre les mots espagnols en italique) est tellement répété qu’il en donne cette impression presque rétinienne.
Didi-Huberman explore les mots, ils les décortiquent pour nous dévoiler toute leur richesse sémantique. Ils les pèsent comme chacun des mouvements du danseur, comme chacune des impulsions du torero.
Et puis on approfondit bien sûr les notions de duende si chère à Federico Garcia Lorca, le duende cette force sous-jacente et le temple, une manière d’adoucir ses gestes tout en les accordant à leur puissance intérieure, le temple c’est ce qui fait que la tauromachie est un art.
Didi-Huberman décrit cette danse, cette vision du monde comme il le ferait d’une tragédie. Autour de ce monde se développe une esthétique qui relève réellement du tragique.
Je ne voudrais pas alourdir ici ce texte en paraphrasant le livre. Cela relève déjà d’un tour de force que de réussir comme le fait Didi-Huberman à approfondir ses impressions sans qu’elles perdent de leur tragique.
J’ai tenté en vain de faire une sélection de quelques citations, pour trancher je n’ai choisi que celle de Garcia Lorca :
« Il cherche son profil sûr,
Et le rêve le désoriente.
Il veut chercher son beau corps
Et trouve son sang ouvert. »
Je ne peux que vous conseiller de lire ce livre. Je n’avais aucun nom de torero en tête, je ne connaissais même pas Israël Galvàn (je crois même que je vais attendre un peu avant de me renseigner), et pourtant on ressent les choses même quand on n’y comprend pas grand chose. Je voudrais écrire comme Didi-Huberman, m’emparer d’un sujet, le choisir, le porter comme il le fait.
A déconseiller évidemment aux Brigitte Bardot et autres. Evidemment.