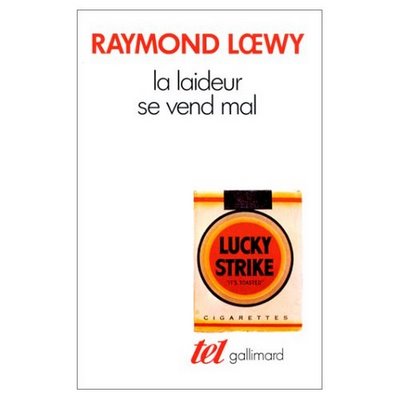New york New york
Cinquante ans d’Art, Architecture, Cinéma, Performance, Photographie et Vidéo
Au Grimaldi Forum
A Monaco
« Star spreading the news, I’m leaving today, I wanna be a part of it, in old New York (…) If I can make it there, I’ll make it anywhere, it’s up to you, New York, New York!» (parce que vous savez que je l’aime cette chanson)
Après la grande exposition Super Warhol organisée en 2003, Monaco, la ville où mêmes les mamies font leur marché en robe de soirée, remet le couvert et accueille cet été pas moins de cinquante ans d’art à New York . Vaste programme.
Après la deuxième guerre mondiale, New York accueille en son sein les avant-gardes artistiques et devient capitale artistique mondiale supplantant ainsi Paris. L’exposition présente ces cinquante ans (plutôt soixante en réalité) de manière chronologique en respectant les mouvements: on y voit donc de l’action painting, de l’expressionisme abstrait, du pop art, du minimalisme et de l’art conceptuel. La présentation des 25 dernières années s’avère plus subjective à cause des fortes individualités artistiques.
La grande force de cette exposition est de présenter des œuvres très représentatives de chaque artiste. Ainsi, on peut voir entre autres la Marylin sur fond rouge de Warhol, le Monument 12 for V. Tatlin de Dan Flavin, la petite fille qui pleure de Diane Arbus, le I shop therefore I am de Barbara Kruger, le Zydeco de Basquiat… La liste est non-exhaustive. Aussi, vous n’avez pas cette frustation de reconnaître l’artiste tout en pensant que vous auriez souhaité voir une autre de ses œuvres. Il n’y a pas cette rencontre manquée.
Je suis restée longuement devant les deux Rothko présentés en vis-à-vis avec une grande toile de Morris Louis qui n’est malheureusement pas reproduite dans le catalogue.
J’ai beaucoup tourné autour d’un grand monochrome noir de Ad Reinhardt, pas si monochrome que ça et terriblement iradiant avec ces reflets bleux par endroits notamment sur la tranche.
J’ai fait des allers-retours entre les salles toutes les deux minutes pour ne pas louper la vidéo de Hans Namuth sur Pollock at work. Et encore arrivée au mauvais moment, j’ai du faire la même chose pour voir walking on walls de Trisha Brown.
Je n’ai pas osé marcher sur les tin square de Carl Andre alors qu’à Beaubourg, j’ai même pas peur mais à Monaco, tout est tellement différent.
J’ai eu mal aux yeux devant l’installation de Nam June Paik et celle de Sol Lewitt.
Je me suis amusée sur le juke-box remasterisé de Laurie Anderson, on m’a dit que j’avais le droit.
Je me les suis gelées dans la salle de Matthew Barney dans laquelle est présentée le cabinet du docteur Houdini et n’ai donc pas pu rester regarder le Cremaster 2.
J’ai observé les réactions d’un groupe de mamies monégasques devant les huit chiots String of puppies de Jeff Koons.
J’ai mangé un bonbon bleu de Felix Gonzales-Torres. Ben oui, ils sont pas spécialement bons ces bonbons mais je peux pas résister d’en gober un. Nicolas Bourriaud, si tu lis cet article, je sais, je sais, l’esthétique relationnelle!
Et à la fin, il y avait mon chouchou, John Currin avec ses femmes si allongées.

Je suis ressortie plutôt contente de cette exposition. Je ne pensais pas voir tant d’œuvres importantes. Les salles sont grandes et il y a peu de monde mais il fait peut-être un peu beaucoup très froid.
Ce qu’on peut malgré tout reprocher à cette exposition c’est le manque de parti pris, parce qu’avouez que ce n’est pas très risqué de présenter de l’art new yorkais mais on peut dire que c’est largement contrebalancé par le fait que les nombreuses œuvres sont de qualité. Oui, l’expo a du coûter une petite fortune, mais on est à Monaco, ne l’oubliez pas.
La scénographie est banale, « basée sur le plan en quadrillage de la Big Apple », banale quoi, mais, encore une fois, ce n’est pas très gênant.
En revanche, la communication est quasi inexistante, l’affiche elle-même est très minimaliste avec son dripping noir. C’est sûr que de cette manière, on évite l’aspect fourre-tout qu’aurait pu avoir ce bilan artistique mais, si on la retrouve dans les textes du catalogue, l’identité new yorkaise n’est pas apparente, elle n’est pas revendiquée. En regard, on peut penser à la récente exposition de Los Angeles à Beaubourg. L’exposition du Grimaldi Forum n’a pas cette âme mais la raison vient peut-être des artistes new yorkais eux-mêmes.
Bien que l’inventaire soit très exhaustif, on a le sentiment que l’exposition n’est qu’une occasion de voir de très grandes œuvres. Mais c’est une très belle occasion!