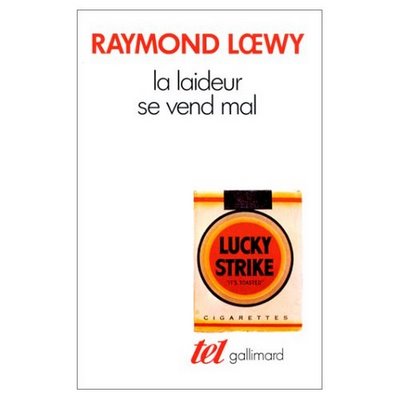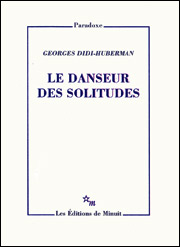Une seconde une année
De septembre à décembre 2006
Au Palais de Tokyo

Aller au palais de tokyo un dimanche après-midi.
Arriver juste au moment où l’on remballe l’atelier tok-tok. Les enfants courent encore partout.
Arrêter de se la péter genre moi, tu sais l’art contemporain, ça me connaît, et juste kiffer.
Parcourir l’exposition en rebondissant d’une œuvre à une autre, comme toujours happée par la suivante. Prendre tout au premier degré parce que des fois, il faut que l’esprit se repose. Inutile de culpabiliser pour avoir trop souvent zapper devant les frères Bogdanov. Se dire qu’après tout, je n’ai pas envie de réviser les théories sur le big bang avant d’aller voir une expo.
5 milliards d’années, oui, mais aussi peut-être seulement moi (nous), là, maintenant, ici.
Un Michel Blazy très chevelu et très jaune nous accueille. On aimerait s’y glisser comme dans un lavauto. Une sorte de peluche géante sur pattes.

Un peu plus loin, dans une salle sombre clignotante à cause d’une de ses œuvres trop conceptuelles pour ma visite premier degré, un petit chimpanzé. Le même que chez Omo. Debout, les bras en avant dans une position entre le somnambulisme et le darwinisme, il est terriblement intrigant. J’ai dit Darwinisme ? Non, non, restons premier degré.

Un souffle malade se fait entendre. Inspiration-expiration. Court, presque haletant et terriblement angoissant. Ceci ajouté à une lumière violette qui s’allume et s’éteint au rythme du-dit souffle. Soudain, plus rien. J’attends. Soudain, un petit gars pas plus haut que notre omo darwinien lâche un cri perçant comme seul ceux qui ont en dessous de 8 ans peuvent le faire (c’est un âge approximatif que je donne là, hein, ne vous en faîtes pas si votre enfant ne correspond pas à cette statistique). Et là, le souffle se remet en marche. Mais oui, c’est écrit, là, hurlez aussi fort que vous pouvez. Impossible de sortir un son de ma bouche, j’ai 2 fois et demie 8 ans. Je reste alors spectatrice et auditrice amusée de ces deux gamins qui hurlent gaiement chacun leur tour.
Et heureusement qu’ils sont là, un peu plus loin, ils participent encore à l’œuvre. Un autre petit bonhomme est face au mur, mais cette fois-ci, c’est un faux, une sculpture si vous préférez. Nos deux vrais petits garçons titillent le faux, lui tapent sur l’épaule. Certains visiteurs, de loin, les trouvent bien dissipés, non, vraiment, il faut tenir son gosse quand on va au musée. Bam bam bam bam. Un des trois enfants vient de se taper la tête contre le mur, bien fort. Vous en faîtes pas, c’était le faux, la sculpture (j’espère que vous suivez). Comme ça, de temps en temps, le mécanisme se met donc en marche et fait peur à tous les visiteurs bienveillants.

On en arrive à mon œuvre préférée. C’est une installation dans une petite salle. Elle s’appelle flying tape. 8 ventilateurs sont regroupés au centre et renvoient de l’air au quatre coin de la pièce. Une fine bande de film se balance, ondule sur le souffle des ventilateurs. La bande est nouée de manière à former un cercle. Elle ne tombe jamais, elle danse et circonscrit un espace d’air dans lequel on entre et on sort avec légèreté. Si vous achetez le nouveau magazine Palais, vous y trouverez un article qui traite de flying tape de manière scientifique. Une œuvre est toujours plus forte lorsqu’elle possède différents niveaux de lecture. Oubliant un peu mon premier degré de rigueur, j’ai choisi une interprétation poétique de flying tape.
Rester un moment, sourire niaisement, parce que si on ne peut plus hurler, on peut encore sourire niaisement. Esquisser quelques pas de danses maladroits se voulant des plus légers. Oui, voilà.